DICTIONNAIRE des TERMES BOUDDHIQUES
français, japonais, chinois, sanscrit, pali
Mandala
DICTIONNAIRE des TERMES BOUDDHIQUES français, japonais, chinois, sanscrit, pali Mandala |
|
Mandala : littéralement cercle, disque, sphère. Symbole graphique sacré utilisé dans le bouddhisme comme "moyen" ou "voie" pour la méditation. L'origine des mandalas est mal connue. Une des théories établit un lien entre les mandalas et les constructions cultuelles mégalithiques du type de Stonehenge en Angleterre. D'autres font le rapprochement avec les miroirs de bronze de la dynastie des Han qui représentent la création du monde. Une troisième explication se réfère aux tambours des chamanes sur lesquels était peinte la carte du monde. Il semblerait que la partition du cercle en quatre soit largement universelle dans la représentation du "divin" et, plus largement, de l'harmonie. |
|
|
|
Les premiers mandalas historiquement attestés (dans le Natyashastra)
sont liés aux rituels tant védiques et non-védiques.
Ce sont des représentations symboliques de l'univers. Le cercle,
symbole de totalité, est divisé en 4 modules, les quatre
directions cardinales. Là se trouvent des portes gardées
par quatre gardiens, les dikpala
(Indra - pour l'est ; Varuna
- ouest, Yama - sud ; Kubera
- nord). Le centre est généralement occupé par Brahama.
Au cours des temps ce schéma devient plus complexe par l'adjonction
de directions intermédiaires et de nombreuses déités. |
Le bouddhisme
s'est inspiré de ces mandalas hindouistes et en retour a modifié
la structure des mandalas de l'hindouisme classique. Différentes
variantes ont été adoptées au Tibet, en Asie Centrale,
en Mongolie, en Chine et au Japon. Les mandalas sont représentés sur des toiles, le sol, les plats sacrificiels, en utilisant différents matériaux (peinture, sable coloré, pierres, etc.) Les couleurs étaient strictement codifiées |
 ... ... ... ...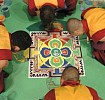 ... ... ... ...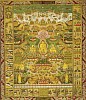 |
Bien que dans la pensée
indienne la terre soit ronde, le quadrilatère joue une rôle
essentiel en tant que figuration des points cardinaux qui relient le ciel
et la terre Le lever et le coucher du soleil déterminaient la forme
et l'orientation des autels rectangulaires. Le quadrilatère et
le cercle se combinent de différentes façons. On note cependant
deux tendances : cercle divisé en maisons (16, 32 ou 64) de divinités
ou bien carré divisé en 81 modules. Ce dernier représente
le monde parfait après le sacrifice de Purusha,
l'être primordial de l'Inde. Il représente l'immortalité
du premier homme. |
 ... ...
 |
Les premiers textes bouddhiques
qui mentionnent les mandalas datent du IIIe siècle Le Sutra
du Lotus évoque le mandala en tant qu'espace sacré
des bouddhas atemporels, les bouddhas de la méditation (dhyana
bouddha). Le Sutra Vairocana
précise l'espace de chaque bouddha. Mais ces localisations géographiques
ne sont pas pour autant des guides pour la méditation. C'est au
Tibet vers le VIIIe siècle que se généralise l'utilisation
de la représentation graphique de l'univers en tant que support
à la méditation. Le méditant intériorise les
forces de l'univers à travers les différents symboles représentés.
Par degrés (différentes "portes") le regard se
porte vers le centre pour s'unir avec le Bouddha cosmique qui représente
la vérité suprême de toute la diversité des
mondes et des univers. Plus tard, ce Bouddha central a pu être remplacé
par différentes déités et on utilisa des mandalas spécifiques selon les circonstances.. Alors que l'Inde et l'Asie s'orientent vers des mandalas de pierre (stupa ou tours pyramidales) que le Tibet excelle en peinture, la Chine et à sa suite la Japon, donnent une autre dimension au mandala. La calligraphie en Chine est plus qu'un art. Elle a une valeur spirituelle car elle exige la parfaite maîtrise de soi et "l'élégance du cœur". Le calligraphe s'incarne dans le tracé de son pinceau. |
 ... ... ... ... ... ...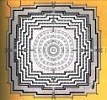 ... ... |
Au Japon, à l'époque
de Nichiren à côté de mandalas figuratifs, la coutume
se répand d'inscrire en caractères chinois (kanji)
les principes de base d'un courant spirituel. Les temples shinto
et bouddhistes distribuent aux fidèles des ofuda,
tablettes comportant le nom d'une divinité ou une formule protectrice,
poursuivant ainsi la coutume des gofu (talismans).
Les ofuda sont parfois des parchemins que l'on
déroule à l'intérieur de l'autel familial. Les gofu portent le nom d'une divinité protectrice (ou son image), une formule
ou le titre d'un sutra (kyomon), le plus
souvent celui du Daihannya kyo (Mahaprajnaparamita)
qui devait être lu pendant la pratique. Le nombre de fascicules
(jusqu'à 600) incitait à le lire par "roulement".
On adopta très rapidement le principe tantrique
selon lequel le titre (daimoku) ou la formule
incantatoire (dharani) d'un sutra résume
le pouvoir du texte tout entier. Dans les sanctuaires shinto
le nombre d'invocations ou "purifications" était inscrit
sur une pièce d'étoffe, conservée dans un coffret.
Lorsque le syncrétisme du shinto et du bouddhisme imposa l'usage
de réciter des sutras, le comptage des invocations devint un objet
de polémique. Principalement dans l'école de la Terre pure.
|
 ... ... ... ... ... ... ... ... |
|
Les premiers honzons
de Nichiren s'inscrivent dans cette tradition, à la différence
qu'il proclame la suprématie absolue du Sutra
du Lotus, Myoho Renge Kyo.
A mesure que la communauté de ses disciples grandit, les Gohonzons deviennent plus universels. Nichiren revient à la tradition des
Quatre Grands Rois du Ciel et intègre
dans le Gohonzon sous une forme symbolique
la Cérémonie de la Tour aux Trésors
ainsi que le principe d'ichinen sanzen,
essence du Sutra du Lotus. |